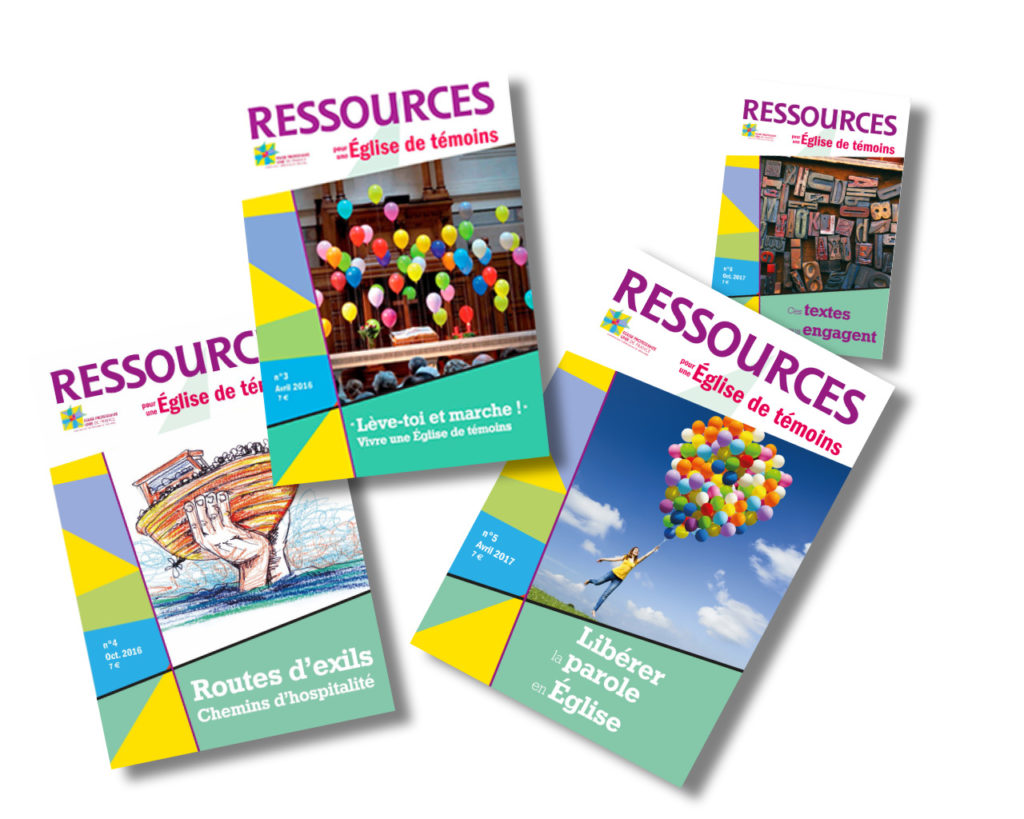Les grands axes du projet khi
Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ?
Luc 24:32
Ci-dessous, vous trouvez des informations sur les pistes de recherche du projet Khi, tels que présentés aux Conseils des lieux d’Eglise en juin 2014. Le dépliant de présentation peut être téléchargé ici [pdf 1,2 Mo].
 La recherche active
La recherche active
La société change rapidement. Comment adapter nos offres ? Comment être créatif sans renier nos traditions ?
Il s’agit de développer, pour tout groupe constitué (région, paroisse, aumônerie, etc.) une méthode de travail. Celle-ci consiste à évaluer les actions entreprises pour analyser les enjeux, améliorer leur impact et en tirer des enseignements. L’objectif est de permettre à tout groupe d’entrer dans un processus permanent d’apprentissage.
Télécharger la présentation d’un protocole en cours d’élaboration [pdf 193 Ko]
 Un outil de diagnostic
Un outil de diagnostic
Quels sont les éléments qui permettent à un groupe de progresser ? Quels sont les points forts et les carences ?
Il s’agit de donner aux groupes (paroisses, régions, etc.) des outils leur permettant d’effectuer un autodiagnostic. Ces outils se basent sur une récente recherche de l’Eglise anglicane d’Angleterre. Celle-ci a pu identifier des éléments liés à la croissance de ses paroisses. Nous souhaitons offrir ces éléments comme un cadre de réflexion et d’interpellation, avec le souhait de stimuler de nouveaux élans.
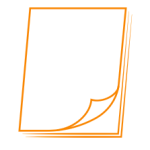 Des bases de formation
Des bases de formation
Après l’information, la formation est un élément clé des processus d’évolution. Nous concevons la formation comme un processus intellectuel, relationnel et spirituel.
La sensibilisation des personnes engagées dans l’Eglise à la thématique de l’évangélisation est une piste importante. Nous souhaitons mettre à disposition des outils de gestion de groupe et des formations destinées à encourager les personnes engagées en Eglise.
Nous travaillons à l’élaboration d’un bref parcours d’initiation à la spiritualité chrétienne. Au travers d’un canevas simple et d’une méthodologie soignée, nous souhaitons offrir un outil facile d’accès pour cheminer à la découverte de certains trésors de la foi.Ces formations sont élaborées en lien avec l’ORH (Office des Ressources Humaines) ainsi que Cèdres Formation et, dans une moindre mesure, l’OPF (Office Protestant de Formation).
 Communication et information
Communication et information
L’évangélisation est une réalité dynamique et en évolution permanente. Le changement et l’adaptation sont des mots qui revêtent toute leur importance.
Portant le souci permanent de questionner nos pistes de travail, nous avons mis en place une veille théologique, spirituelle, et intellectuelle, en lien avec des projets et des programmes similaires dans les pays voisins. Nous nous tenons informé des dynamiques de « croissance d’Eglise » et nous communiquons sur notre site web l’essentiel de ces découvertes. Nous informons également sur les initiatives qui émanent des paroisses de l’EERV dans l’idée de les valoriser. Sur notre site, nous publions des prises de position, nous offrons des espaces de discussion (commentaires) et nous mettons à disposition les outils développés.
 Valorisation d’outils « clé en main »
Valorisation d’outils « clé en main »
La créativité est présente, mais parfois peu visible. L’initiative est présente, mais peut être mieux mise en valeur.
De nombreuses initiatives locales font la satisfaction des groupes qui les portent. Malheureusement, leur rayonnement ne dépasse pas souvent le cercle paroissial. Fort de ce constat, nous élaborons un catalogue d’outils, de propositions, d’idées fécondes permettant à d’autres d’être nourris et stimulés par un travail déjà en partie accompli et éprouvé.
 Espace de créativité et de recherche
Espace de créativité et de recherche
De nombreuses personnes, au sein de l’EERV, portent la préoccupation de l’évangélisation. Comment les mettre en lien ? Comment valoriser les bonnes idées ?
Convaincus de l’importance de valoriser des espaces de créativité, nous cherchons à rassembler des personnes motivées (laïcs et ministres) autour de la thématique de l’évangélisation. Un « réseau khi » a été mis sur pied par le biais du site web projetkhi.eerv.ch. Il est constitué d’une lettre de nouvelles ouverte à tous ainsi que de soirées informelles et conviviales destinées à brasser des idées.
 Au calendrier 2014
Au calendrier 2014
Deux événements que nous aimerions particulièrement souligner.
6 septembre Stand d’information et de contact lors de la Journée EERV, à la cathédrale de Lausanne.
21-22-23 novembre Des journées de partage et de découverte à Crêt-Bérard. Intitulées « vitamine-é », ces journées ont pour but d’encourager les groupes déjà constitués (lieux d’Eglise, Conseils, aumôneries, etc.), de leur permettre de partager leurs bonnes idées et de leur proposer des idées nouvelles.
Organisé avec Crêt-Bérard et l’ORH. Une participation partielle à ces journées est possible.
JCE/AVA 19 mai 2014