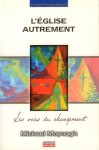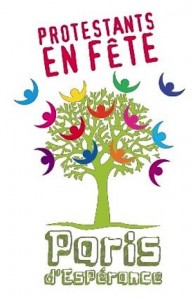Les chances de la sécularisation
Par Henri Piguet, pasteur, ancien journaliste RP.
Dans l’Eglise, le mot sécularisation sonne mal. Pour les croyants, la sécularisation serait une déchéance, le commencement de la fin.
Ce dont le Synode s’inquiète à juste titre, c’est que la foi chrétienne et ceux qui la professent soient marginalisés. Les médias ne s’intéressent qu’aux scandales qui affectent l’Eglise catholique, et les protestants sont tout simplement ignorés, sauf pour souligner parfois leur nombre en diminution.
Il y a là de quoi s’inquiéter, en effet. Mais c’est méconnaître la sécularisation que de la confondre avec ce mépris. Selon le professeur strasbourgeois Roger Mehl, qui s’y est intéressé de près au milieu du XXe siècle, la sécularisation est la reprise progressive par la société civile de toutes les valeurs de l’Evangile et des activités qui furent à l’origine celles de l’Eglise.
En maints domaines, des chrétiens ouvrirent la voie avant d’être suivis par la société civile, avec plus de moyens grâce à l’argent public. Des exemples ? Ils ne manquent pas. La Croix-Rouge, fondée à Genève par quelques membres de l’Union chrétienne, n’a plus aucune couleur confessionnelle. L’AVS a fait suite à Pro Senectute, œuvre d’Eglise autrefois seule à donner quelques moyens de subsistance aux personnes âgées. Des infirmières laïques, dans les hôpitaux, ont remplacé les diaconesses. La Croix-Bleue, fondée par un pasteur vaudois, a ouvert la voie aux services chargés de prévenir la dépendance à l’alcool, et les jeunes chrétiens qui, dans les années septante, accompagnaient les toxicomanes furent relayés bientôt par des éducateurs professionnels. La sécularisation, dans tous ces domaines, affaiblissait l’influence de l’Eglise, mais lui rendait indirectement témoignage. En cela, elle ne fut pas entièrement négative !
La préoccupation du Synode est compréhensible. Pour pallier la marginalisation à laquelle les croyants sont réduits aujourd’hui, une démarche en deux temps paraît possible.
Premièrement, bien identifier les valeurs auxquelles la société reste attachée ; car s’il est vrai que l’individualisme à outrance, l’égocentrisme et l’amoralisme y sont omniprésents, il apparaît pourtant qu’en certaines occasions, une forme de générosité fait surface. Une catastrophe proche ou lointaine, des enfants victimes de la famine ou mis aux travaux forcés par des exploitants sans scrupules, voilà qui ne laisse personne indifférent.
Ensuite, s’approcher de certains faiseurs d’opinion : journalistes, enseignants, hommes et femmes politiques, et leur montrer que les valeurs qui subsistent sont toutes d’origine chrétienne. Par là, leur faire découvrir qu’une Eglise confessant la foi en Jésus-Christ n’est pas un corps étranger dans la société.
Lourde tâche ? Oui, mais c’est la nôtre.