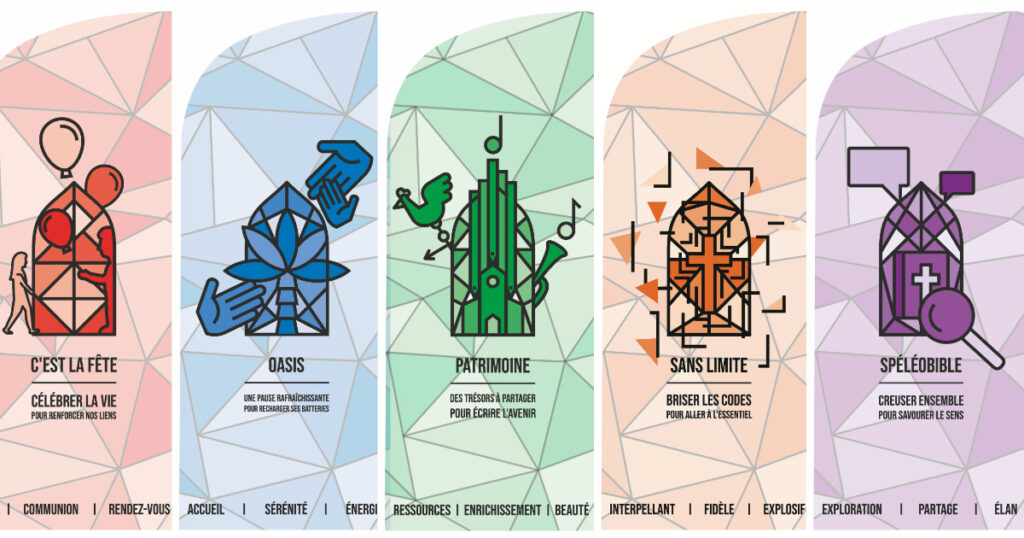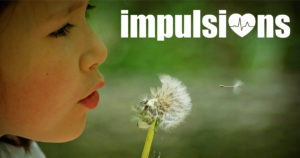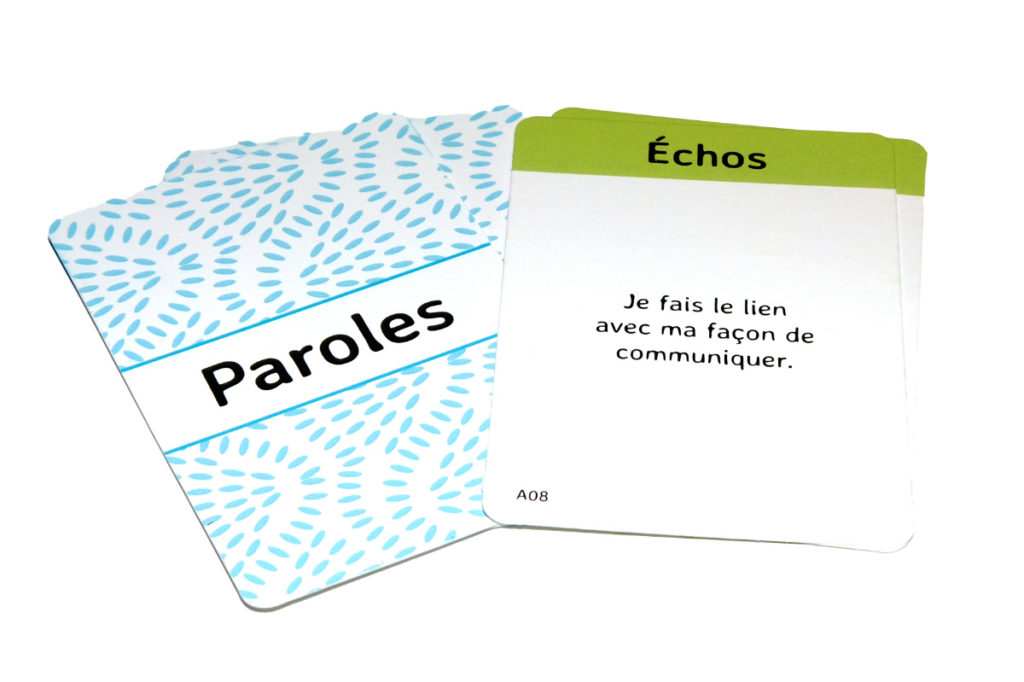Trois communautés pour un culte
Depuis quelques mois à la Paroisse de Bellevaux – Saint-Luc, le diacre Jules Neyrand célèbre des cultes en commun avec des réformés suisses, des réformés camerounais, et des érythréens pentecôtistes. Coup d’œil sur ces cultes mixtes dit « mosaïques ».
Un vrai « tous ensemble »
Depuis quelques mois, la Paroisse réformée de Bellevaux – Saint-Luc propose, trois dimanches par mois, des célébrations « mosaïques ». Celles-ci réunissent les membres historiques de la paroisse, mais aussi la communauté réformée camerounaise locale et la communauté érythréenne pentecôtiste de Lausanne. Jules Neyrand, diacre nouvellement arrivé dans la paroisse, est le moteur et le principal célébrant de ces temps de spiritualité. Lui et les pasteurs des deux communautés africaines mettent les traditions de chacun sur un pied d’égalité dans un esprit de dialogue.
L’histoire d’un rapprochement
 « Tout est parti d’une étude de terrain quand je suis arrivé en poste à la paroisse » explique le diacre. « J’ai vu qu’il y avait deux communautés d’origines africaines qui étaient des forces vives dans le quartier. Notre paroisse leur prêtait les locaux le week-end, mais on se croisait sans vraiment se parler. Chacun avait beaucoup de clichés sur les autres ». Jules Neyrand a donc démarché les deux communautés, qui se sont montrées très enthousiastes à l’idée de collaborer. En basant le rapport sur la confiance, l’ouverture et l’égalité, l’idée d’un culte « mosaïque » a émergé. « Il s’agit d’un projet collectif, porté par toutes les communautés, pas seulement par moi », assure le professionnel avec énergie. Célébrés depuis 6 mois, ces temps partagés de spiritualité ont servi de tremplin à un rapprochement plus large. « Aujourd’hui, le Conseil de paroisse compte un représentant de chacun des deux groupes », explique avec fierté Jules Neyrand, heureux d’avoir contribué à bâtir un dialogue entre les communautés.
« Tout est parti d’une étude de terrain quand je suis arrivé en poste à la paroisse » explique le diacre. « J’ai vu qu’il y avait deux communautés d’origines africaines qui étaient des forces vives dans le quartier. Notre paroisse leur prêtait les locaux le week-end, mais on se croisait sans vraiment se parler. Chacun avait beaucoup de clichés sur les autres ». Jules Neyrand a donc démarché les deux communautés, qui se sont montrées très enthousiastes à l’idée de collaborer. En basant le rapport sur la confiance, l’ouverture et l’égalité, l’idée d’un culte « mosaïque » a émergé. « Il s’agit d’un projet collectif, porté par toutes les communautés, pas seulement par moi », assure le professionnel avec énergie. Célébrés depuis 6 mois, ces temps partagés de spiritualité ont servi de tremplin à un rapprochement plus large. « Aujourd’hui, le Conseil de paroisse compte un représentant de chacun des deux groupes », explique avec fierté Jules Neyrand, heureux d’avoir contribué à bâtir un dialogue entre les communautés.
Les valeurs du culte mosaïque
« Une des lectures qui a le plus stimulé ma réflexion paroissiale est le livre sur l’Église interculturelle d’Espoir Adadzi, le pasteur genevois originaire du Togo », raconte encore le bouillonnant diacre. Il ne s’agit pas simplement de cohabiter mais de créer une véritable mosaïque de pratiques. «Il y a de très beaux éléments liturgiques de ces communautés que j’ai voulu mettre en avant et qui, je pense, peuvent être une réelle source d’inspiration pour d’autres» . Et de citer des gestes de bénédiction en binôme ou des chants liturgiques d’origine africaine.
«Mettre en place ces cultes et y participer, c’est une vraie initiation au pluralisme religieux, pour les Suisses comme pour les autres». Dans ces cultes, l’idée est de mettre en avant la diversité des paroissiens, les invitant à prier et à chanter dans différentes langues. « Tout le monde doit se sentir un peu déplacé par la rencontre et le dialogue », affirme le diacre. « Une autre chose très belle que j’ai prise de ces communautés, c’est l’intergénérationnalité », ajoute-t-il. « Aux cultes mosaïques, on essaie de mettre en avant les enfants, petits et grands, et de les faire participer au maximum. Nous nous souhaitons inclusifs à plus d’un titre».
Des défis et des espoirs
 Si le pari du rapprochement semble réussi, il existe encore des défis à relever. L’ambitieux diacre rêve de mettre les trois communautés sur un pied d’égalité. « Le problème que je rencontre n’est souvent pas tant le racisme qu’une forme de condescendance. C’est la principale chose à combattre dans notre effort de dialogue. Aujourd’hui, je suis toujours l’officiant principal , mais on œuvre pour que les choses changent, et pour laisser une place égale à chacun. Ce qui soulève parfois des résistances : la barrière de la langue est parfois aussi un obstacle, surtout pour la communauté érythréenne. Je milite pour que la paroisse se fasse appeler ‘paroisse mosaïque’ au lieu de simplement ‘paroisse réformée’, afin de pleinement embrasser notre nouvelle identité et ce nouveau dynamisme venant de la rencontre. Mais il y a encore du chemin à parcourir avant que tout le monde saisisse l’enjeu de cette démarche » confie le jeune ministre, déterminé mais pragmatique. S’il n’y a pas encore eu de projet analogue dans d’autres paroisses du Canton de Vaud, Jules Neyrand assure que de plus en plus de personnes se disent séduites par la proposition et envisagent de suivre l’exemple.
Si le pari du rapprochement semble réussi, il existe encore des défis à relever. L’ambitieux diacre rêve de mettre les trois communautés sur un pied d’égalité. « Le problème que je rencontre n’est souvent pas tant le racisme qu’une forme de condescendance. C’est la principale chose à combattre dans notre effort de dialogue. Aujourd’hui, je suis toujours l’officiant principal , mais on œuvre pour que les choses changent, et pour laisser une place égale à chacun. Ce qui soulève parfois des résistances : la barrière de la langue est parfois aussi un obstacle, surtout pour la communauté érythréenne. Je milite pour que la paroisse se fasse appeler ‘paroisse mosaïque’ au lieu de simplement ‘paroisse réformée’, afin de pleinement embrasser notre nouvelle identité et ce nouveau dynamisme venant de la rencontre. Mais il y a encore du chemin à parcourir avant que tout le monde saisisse l’enjeu de cette démarche » confie le jeune ministre, déterminé mais pragmatique. S’il n’y a pas encore eu de projet analogue dans d’autres paroisses du Canton de Vaud, Jules Neyrand assure que de plus en plus de personnes se disent séduites par la proposition et envisagent de suivre l’exemple.
Ce vent de fraîcheur liturgique ne souffle pas que sur les membres des trois communautés : « La semaine dernière, nous avons eu notre premier nouveau venu au culte grâce aux réseaux sociaux : il a vu nos cultes sur notre compte Instagram et est venu célébrer avec nous. C’est une victoire pour notre équipe, qui travaille depuis plusieurs mois sur l’identité digitale de la paroisse et de nos cultes particuliers. On espère que ce nouveau participant sera le premier d’une longue série », conclut Jules Neyrand.